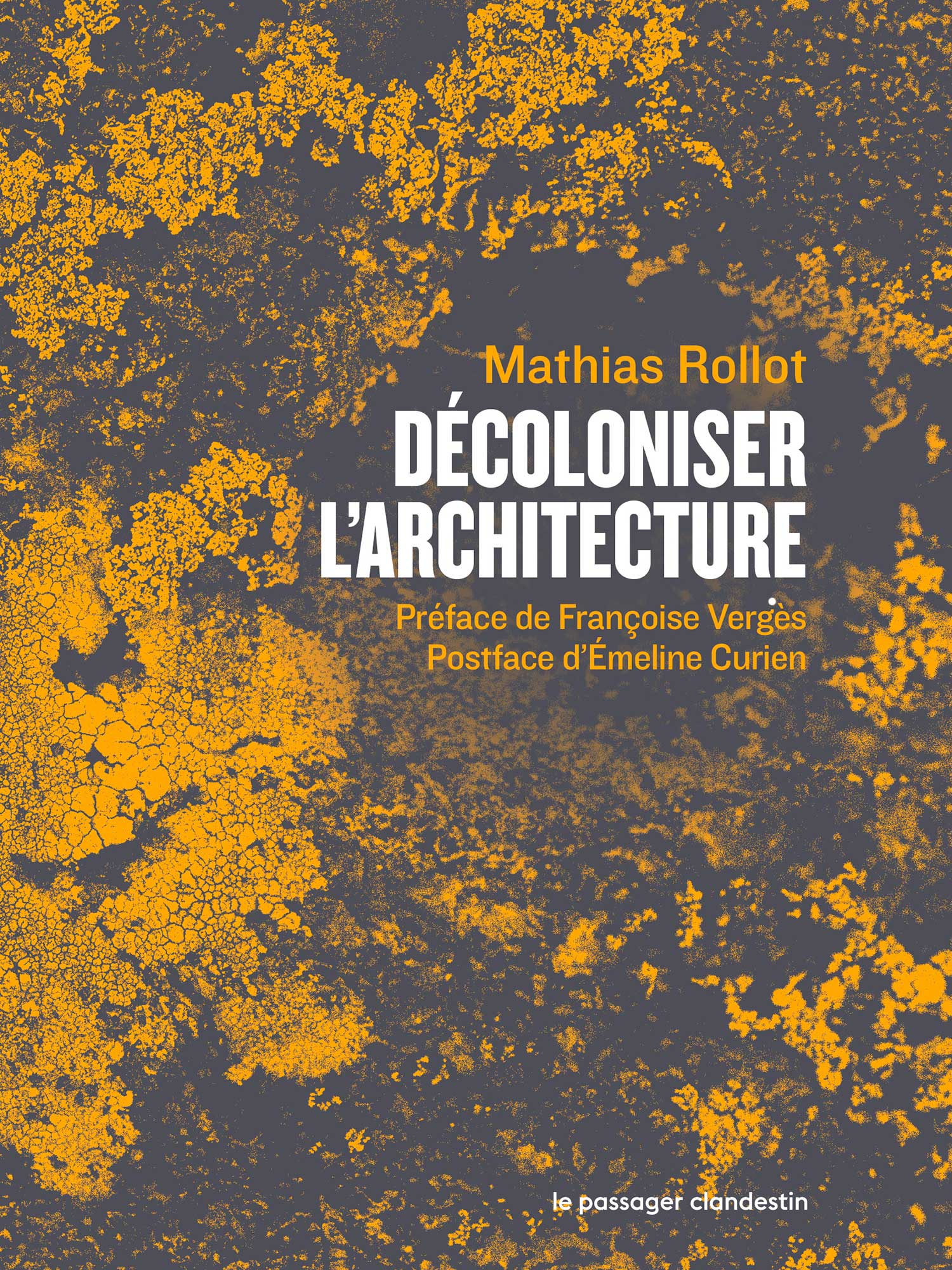Transformer le paysage intérieur est seulement la première étape. À moins de changer les structures de la culture, nous les refléterons encore et encore.Starhawk, Rêver l’obscur, op. cit., p. 127.
Prendre au sérieux la nécessité de bâtir une société autre tout en croyant à l’architecture, c’est probablement déjà dire la nécessité d’une architecture autre, qui puisse nous aider à devenir nous-mêmes des autres : d’autres habitant·es, plus terrestres. Une « autre architecture », qui a sa longue histoire, et surtout dont les sens et intérêts dépassent largement le seul produit fini, trouvant aussi dans les processus du concevoir et du bâtir de véritables « fins en soi », des patrimoines vivants sains et créateurs, à nourrir. C’est à cela même que souhaite contribuer l’hypothèse de l’architecture décoloniale – une architecture qui cherche les manières de se placer à la fois au service de l’humain et du non-humain, de cultiver les mondes culturels et naturels. Et de toute façon, comment croire qu’il puisse en être autrement ? Nombreuses sont les démonstrations montrant l’impossibilité d’étudier les problématiques écologiques sans prise en compte, simultanée et radicale, des processus croisés d’apartheid, de colonisation ou de racisme qui y sont liésParmi bien d’autres : Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, Seuil, 2019 ; Estienne Rodary, L’apartheid et l’animal. Vers une politique de la connectivité, Wildproject, 2019 ; Baptiste Lanaspèze, Nature, Anamosa, 2022., pour autant que « la crise raciale […] et la crise écologique ont des conséquences l’une sur l’autre », voire « sont dans les faits une seule et même crise, une crise inhérente au mode dominant d’habitation du monde que les dominations raciale et écologique reproduisentGhassan Hage, Le loup et le musulman, Wildproject, 2017, p. 22-23. ».
Cette invitation se rapproche de la volonté de la chercheuse américaine Julia Watson de mettre en lumière « l’architecture de l’autochtonie radicale » (radical indigenism) dans son ouvrage Lo-TEK Julia Watson, Lo-TEK. Design by Radical Indigenism, Taschen, 2019.. Par le concept de « savoir écologique traditionnel » (traditional ecological knowledge), l’autrice recompose et assemble les différentes pratiques qu’elle a pu rencontrer au fil de ses voyages à travers toute la planète. Les synergies productives qu’elle décrit sont des modèles territoriaux, paysagers et architecturaux à la fois, développés par les peuples en alliance avec d’autres espèces. On y trouve des systèmes de terrassement philippins et balinais capables de former des bassins qui sont à la fois des lieux de cultures végétales et animales ; des ponts vivants construits avec des lianes en croissance permanente, capables de résister bien mieux que n’importe quel autre aux intempéries locales ; des systèmes de traitement écologiques des eaux usées en Inde qui sont aussi des pêcheries productives, des champs et des parcs urbains ; des constructions frugales, solides et fonctionnelles, quoique entièrement compostables, bâties au moyen de technologies appropriées avec des matériaux hyperlocaux. Un·e biologiste dirait sans doute qu’il s’agit là de symbiose, de collaboration interspécifique mutualiste. Un·e écologiste dirait qu’iel observe des sociétés sainement ancrées dans leurs milieux. Mais il semble qu’il faudra bien des efforts à un·e architecte français, en revanche, pour assumer qu’il puisse s’agir là « d’architecture ». C’est précisément cela qui pose problème et à quoi il faut remédier au plus vite. Pour Julia Watson,
Concevoir depuis l’autochtonie radicale, c’est s’inscrire dans un mouvement cherchant à retrouver le sens des philosophies autochtones en matière de conception pour générer des infrastructures soutenables et climatiquement résilientes. Ce mouvement lo-TEK comble le vide existant à l’intersection entre l’innovation, l’architecture, l’urbanisme, l’écologie et l’autochotonie. (…) [il] nous oriente vers une tout autre mythologie technologiqueJulia Watson, Lo-TEK, op. cit., p. 18..
Il est assez simple de voir en quoi le travail titanesque réalisé par Julia Watson et son équipe s’inscrit dans une logique pluriversaliste. Ce concept ancien a récemment été popularisé par l’anthropologue Arturo Escobar. Les définitions qu’il en donne dans son ouvrage Sentir-penser avec la Terre. Une écologie au-delà de l’Occident sont multiples. Le plurivers y est décrit comme « un monde dans lequel tiendraient de nombreux mondes », autant qu’« un ensemble de mondes en connexion partielle les uns avec les autres, qui n’ont de cesse de s’énacter et de se déployerArturo Escobar, Sentir-penser avec la Terre. Une écologie au-delà de l’Occident, Seuil, 2018, p.129. ». C’est un outil décolonial, une accroche à saisir pour déconstruire l’idéologie moderne, des cosmologies croisées de la consommation, du progrès et du développement, vers un « post-développementAshish Kothari, Ariel Salleh, Arturo Escobar, Federico Demaria, Alberto Acosta (dir.), Plurivers. Un dictionnaire du post-développement, Wildproject, 2022. ». À l’opposé d’une universalité synonyme d’uniformisation, voire de colonisation, un plurivers est composé d’une multitude de mondes hétérogènes. Parler de plurivers, c’est croire en l’intérêt d’une coexistence symbiotique de cosmologies multiples.
Sentir-penser en termes de plurivers est un excellent moyen de toucher du doigt les fondements les plus intéressants du principe biorégional, en tant qu’il est basé sur des principes de localités ouvertes, de communautés autonomes en métamorphoses permanentes, de symbioses natureculturellesDonna Haraway, Manifeste des espèces compagnes, Flammarion, 2019. ni globalisées ni globalisantes, de microcultures en dialogues et en apprentissages permanents. C’est dans le contexte de ce pluriversalisme – de ce biorégionalisme-là – qu’il me semble aujourd’hui nécessaire de réorienter nos enseignements-recherche en architecture si nous voulons sortir à la fois de « l’autonomisme » historique de la discipline et de ses aspects occidentalocentrés, anthropocentrés et encore largement progressistes et développementistes. C’est en ce sens que l’idée de « diversité disciplinaire » s’accorde bien avec les principes fondateurs du biorégionalisme – le fait qu’il n’y a pas de comportement écologique universel, et qu’en chaque point de la biosphère, pensées et actions doivent s’ajuster aux réalités biorégionales auxquelles elles participent. Ainsi peut-on lire, dans le très stimulant dictionnaire du « post-développement » évoqué : « Ensemble, ces perspectives composent un “plurivers” : un monde où une multitude de mondes cohabitent, selon la définition des zapatistes du ChiapasAshish Kothari et al., Plurivers, op. cit., p. 35.. »
C’est bien à un « profond processus de décolonisation intellectuelle, émotionnelle, éthique et spirituelleIbid., p. 21. » qu’il faudra accepter de se livrer pour entrevoir en quoi tout cela nous concerne, nous architectes occidentaux, au premier plan. Ce qu’il s’agit d’entrevoir, c’est notamment en quoi un profond ethnocentrisme, un fort occidentalocentrisme, voire même un eurocentrisme, fondent la grande part de nos réflexes architecturaux, alors même qu’une large diversité culturelle habite nos pays et que nos actions locales ont d’immenses conséquences à échelle globale. Ce qu’il s’agit de réinterroger, c’est la manière dont les références architecturales qui composent nos imaginaires sont presque toutes occidentales, modernes et « expertes » (dans le pire sens du terme). Ce qu’il s’agit d’assumer, c’est en quoi toute la pensée du « développement » (fût-il « rural », « durable » ou « vert ») à laquelle nous contribuons activement est encore mâtinée de colonialisme, d’impérialisme, d’extractivisme, de progressismes – bref, d’une somme considérable d’idéologies nauséabondes, dont d’autres peuples que nous font les frais (pour ne rien dire du non-humain). Et, en définitive, qu’« il n’y a pas d’innocence blanche », pour autant que « le confort des vies en Europe s’est construit sur l’extraction et l’exploitation du Sud global, ce dont même les classes populaires ont fini par profiterFrançoise Vergès, Programme de désordre absolu. Décoloniser le musée, La fabrique, 2023, p. 20. ».
Face au « régime de la ressemblance universelle », on peut donc revenir à l’anthropologie anarchiste de Pierre Clastres, dont l’anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro nous dit qu’elle nous fait admirer « la dignité existentielle de ces “images de nous-mêmes” dans lesquelles nous ne nous reconnaissons pas, et qui ainsi maintiennent leur inquiétante altérité, c’est-à-dire leur autonomieIbid., p. 29. ». Et si Clastres a raison d’affirmer que « les sauvages veulent la multiplication du multipleEduardo Viveiros de Castro, Politique des multiplicités. Pierre Clastres face à l’État, Dehors, 2019. », le présent appel est alors plutôt un manifeste pour des architectures « sauvagesDans Rester barbare, Louisa Yousfi différencie les termes de « sauvages » et de « barbares » en précisant que « le barbare n’est pas le sauvage. Tandis que le barbare est un être irrécupérable, le sauvage, lui, est à développer ». De sorte que, dans l’emploi populaire et médiatique notamment : « Quand ils ont l’air inoffensifs, ce sont des sauvages. Quand ils se rebiffent, ce sont des barbares. » Louisa Yousfi, Rester barbare, La fabrique, 2022, p. 22, p. 15. Si le propos de l’autrice est éminemment convaincant, il apparaîtra pourtant que le terme de sauvage n’est pas employé ici comme un synonyme de quelque chose « d’inoffensif » ou « à développer ». » – un manifeste pour une multitude d’architectures de la multiplicité.
L’enjeu est celui de la multiplication des images concrètes que peut prendre, qu’a déjà prises et que pourrait encore prendre, le concept d’humain. Il ne suffit pas de s’affirmer de bonne foi, et de dire, avec l’architecte Renzo Piano (coauteur de Beaubourg) qu’il est « tout simplement impossible » qu’un architecte ne soit pas « attentif à l’autreRenzo Piano, La désobéissance de l’architecte, Arléa, 2009, p. 49. ». Quelle naïveté ! Encore faut-il faire l’expérience, par quelque moyen que ce soit, de la puissance de ces altérités radicales, humaines et autres qu’humaines, qui peuplent le monde à nos côtés, et que nous devons cesser au plus vite de nier et de coloniser de nos modes de vie mortifères. Dans les faits, bien peu d’architectes, volontairement ou non, trouvent l’intérêt, le temps et les moyens de considérer ces altérités radicales dans leurs projets de transformation construite de la biosphère. Le philosophe Hicham-Stéphane Afeissa a raison de plaider « pour une écologie de la différence » en faveur d’une reconnaissance et d’un maintien de l’étrangeté radicale des animaux (humains et autres qu’humains) arrimé au doute et à l’étonnement, voire au « méconnaissableHicham-Stéphane Afeissa, Manifeste pour une écologie de la différence, Dehors, 2021, p. 61. ». Accepter que nous vivions dans un monde largement inconnu, invisible et imprévisible, que nous ne pouvons que fabuler et non « gérerJulie Beauté, Mathias Rollot, « Fabuler l’invisible. Inventaires paysagers des indisponibles », dans Traces et lectures d’un paysage, revue Amplitudes, n° 4, éditions Châtelet-Voltaire, 2021. » : voilà un premier pas salvateur vers des cosmologies plus écocentrées et moins impérialistes à la fois. Accepter ensuite l’altérité, et apprendre d’elle pour ce qu’elle est, sans jamais chercher à réduire l’écart qui nous sépare d’elle, ni les tensions qui naîtront probablement de cet écart : voilà ensuite un second pas qu’on peut faire pour commencer à avancer vers un plurivers. À savoir, sous les mots de Pierre Clastres, que, « lorsque le miroir ne nous renvoie pas notre image, cela ne prouve pas qu’il n’y ait plus rien à regarderPierre Clastres, La société contre l’État, Minuit, 1974, p. 18. ».
Appeler à la fin des prétentions universalistes de l’architecture, ce n’est donc évidemment pas dire que la « qualité » architecturale n’existe pas ou que tout édifice aurait la même « qualité » que tout autre ; c’est rappeler d’une part qu’il existe d’ores et déjà une large variété de façon de définir, d’évaluer et de dire la « qualité » architecturale, et c’est inviter d’autre part à assumer et étendre plus loin encore cette pluralité créatrice. De même qu’appeler à la fin des prétentions universalistes de l’Occident, ce n’est en rien soutenir que « tout se vaut » ou, ce qui revient au même, que « plus rien n’a de valeur particulière » ; c’est considérer qu’il existe sur cette planète de nombreuses sociétés et cultures, avec chacune ses propres systèmes de valeurs, et qu’il faut se prémunir de toute tentative d’imposition d’un système sur un autre.
Écologiquement parlant, la représentation de la biosphère qui émerge d’une telle vision pluriverselle de la planète est nécessairement plus kaléidoscopique, à la fois plus riche, mais aussi plus complexe à appréhender que le modèle universaliste qu’elle vise à remplacer. Il faut bien reconnaître que cette vision dépasse en fait la capacité de représentation de l’esprit humain – incapable de se figurer et d’articuler la diversité cosmologique folle dont est constituée la biosphère (sans même parler des potentialités). Mais, paradoxalement, c’est probablement en cela même que ce modèle est précieux : parce qu’irréductible, insolvable, insoluble dans la norme internationale, dans la règle unique et toute autre forme de discours hors sol péremptoire, dont les contenus ne peuvent qu’être contredits par la diversité planétaire (de formes de vie, de cultures, d’identités, de singularités à la fois humaines et non humaines). Exactement comme la « biorégion » est justement un concept précieux en ce qu’il est irréductible à une unique carte figée, parfaitement stable et mesurable ; mais qu’il définit au contraire un ensemble d’écosystèmes interconnectés et mouvants, aux échelles enchâssées et aux processus d’habitation jamais donnés par avance. Et que c’est peut-être aussi là que se tient tout l’intérêt de sentir-penser avec une telle notion.
Comment alors diversifier le regard « cultivé » de l’architecte, cet œil déformé par la discipline et la profession ? Car ce n’est pas simplement que le « regard architecte » est imbibé d’une épaisse couche de mythologie, d’un voile relevant largement du fantasme. On peut aussi constater froidement que ses lignes de force sont aussi très en décalage avec les attentes de notre société. Dynamiter les prétentions de ce regard excluant : voilà un beau programme décolonial, concret et impactant, pour l’architecture ! Car si d’un côté cet œil expert peut bien être utile pour lire les pathologies d’un bâti ancien et concourir à l’établissement d’un diagnostic de réhabilitation fort utile, c’est finalement d’une façon assez peu différente de l’œil de bon nombre d’artisan·es, ingénieur·es et même de bricoleur·ses ordinaires. Et si d’un autre côté il a bien ses propres spécificités (pour déceler une proportion particulière ou un écho à l’histoire de l’architecture, par exemple), cela ne le rend pas tant capable de favoriser l’émergence d’édifices plus à même d’accueillir la diversité culturelle ; cela ne l’aide pas à être pertinent pour prendre soin des sols et des écosystèmes en souffrance et cela ne réduit pas non plus le besoin de formation populaire sur les questions constructives et énergétiques – bref, cela ne contribue que très peu à inventer l’architecture sauvage dont notre siècle a cruellement besoin. À bien des égards, ce regard ne semble qu’au service de lui-même, comme agent de l’expertise, de ses monopoles, structures mutilantes et systèmes de mises en incapacité populaire. C’est donc, une fois de plus, d’un autre regard cultivé, ou plutôt d’un regard autrement cultivé, que nous avons peut-être besoin aujourd’hui sur la question architecturale. Un regard que beaucoup d’architectes ont appris à développer au cours de leur vie, spontanément, par éthique ou par besoin, par hasard ou par intelligence écologique ; mais que la discipline architecturale, en tant que champ de théories et de mythes, de méthodes et de systèmes de valeurs, n’a pas encore réussi à intégrer.
Et que dire de la question esthétique ? C’est l’éléphant dans la pièce que tout le monde fait semblant de ne pas voir. On sait pourtant à quel point puissance esthétique et puissance politique sont liées. Or, quel maléfice, si ce n’est l’enfermement corporatiste, peut avoir aveuglé les milieux de l’architecture, pour qu’ils ne se rendent plus compte que les rapports éthico-esthétiques de leur discipline sont à ce point inopérants dans le monde réel ? Ce monde dans lequel tout le monde se fiche du nombre d’or et du modulor, des alignements et des ordonnancements de façade, des séquences d’entrées et des proportions canoniques, des compositions virtuoses et des détails de menuiserie soigneusement dessinés. C’est une évidence : l’architecte n’a pas à protéger le non-sachant de lui-même ; il n’a pas à le sauver de son ignorance ; il n’a pas à conspirer contre lui pour son propre bien-être (qu’il connaîtrait mieux que lui-même). En aucun cas il ne peut se replier derrière son expertise pour faire valoir qu’il sait mieux qu’autrui ce qui serait bon pour lui.
En d’autres termes, le beau et le bien ne sont pas si simplement reliés l’un à l’autre, pour autant que tous deux sont socialement situés : ce qui implique d’une part qu’ils ne peuvent simplement être décidés, de façon hétéronome, par un expert appartenant à d’autres communautés ; et d’autre part que les relations entre forme et moralité ne valent qu’à l’intérieur d’un unique sous-groupe social. Déconstruire l’impérialisme de la discipline architecturale commence aussi par là. Oui, tout le monde aime les « beaux espaces » – mais pas forcément ceux dessinés par les architectes. Oui, tout le monde aime se tenir dans un « seuil épais », et apprécie probablement « les matières brutes qui accrochent la lumière naturelle au fil de la journée » – mais on n’a pas forcément besoin d’architecte pour cela. En quoi la métamorphose indigéniste de l’architecture ne peut donc s’arrêter à une double question d’esthétique et de performance environnementale, au risque de manquer presque entièrement le tournant anthropocénique et ses nécessités propres. Il ne suffit pas que le l’objet bâti soit bioclimatique, régionaliste et frugal à la fois pour faire autochtone. Il ne suffit pas que l’architecte soit bienveillant et qu’il tente de dessiner des œuvres autrement inspirées, moins « ordonnées » ou pittoresques. C’est dans l’invention d’une autre architecture que celle qui a dominé qu’il faut s’engager, par-delà les catégories simplistes et les solutions toutes prêtes.